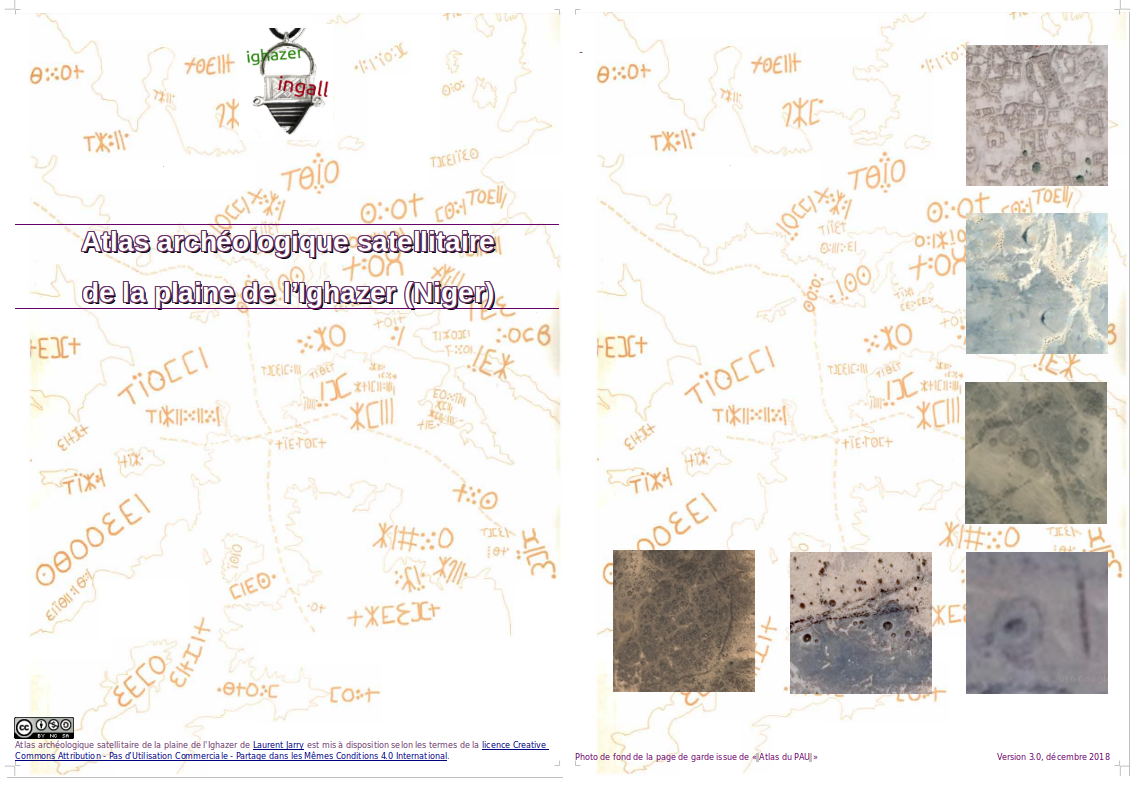Tigidda
Un royaume, une capitale ... et la visite d'Ibn Battuta
L’effervescence qui traversa les tribus nomades sanhadjiennes Gdāla, Lamtūna et Masūfa des rivages atlantiques du Sahara à partir des années 1040, fut le début du mouvement qui allait prendre le nom d’al-murābiṭūn, les Almoravides (Cheikh 2023). Les Sanhadja sont un ensemble de tribus berbères, hommes voilés du désert, dont certains Touaregs sont les descendants les plus directs (Khelifa 2010). Ils furent les premiers à lever toutes les barrières politiques, religieuses, commerciales en établissant un empire allant du Sud du Sahara jusqu’à Al-Andalus. La conversion à l’islam des populations soudanaises, attribuée aux Almoravides par la tradition sunnite dominante, a consisté en fait à leur imposer un islam malékite orthodoxe (Botte 2011).
Read more …
Azelik-Takadda fut une importante cité commerciale, située à environ 130 km au nord-ouest d'Agadez. En surface, se rencontrent nombre de tessons de poteries et autres meules dormantes, mais le plus important sur ce site, demeure certainement les restes d'habitat composés de “bâtiments ouvrant sur une seule cour” et trois mosquées, dont deux possédant un minaret en partie en pierre. De plus, des cimetières d'époque islamique ont également été retrouvés tout autour du site (Bernus et Cressier 2011). Azelik, nom actuel du site de l’ancienne capitale du royaume de Tigidda, aussi appelée Takadda ou Tacâdda par les auteurs arabes et visitée en 1353 par le géographe arabe Ibn Battūta, était une halte caravanière dans le commerce transsaharien entre Boucle du Niger et Égypte, mais aussi un centre d'exploitation et de commercialisation du cuivre. Ce ne fut pas une terminaison d’un axe commercial, mais une halte, un passage obligé pour sa ressource en eau et pour le paiement des droits de traversée du royaume, assurant ainsi la protection des marchandises. Il ne devait pas y avoir non plus de rupture de charge à cette étape, car la ville n’était pas une ville suffisamment peuplée pour développer un marché important à approvisionner, tout au plus les caravanes devaient-elles se fragmenter pour poursuivre leur route vers Gao, le Bornou ou vers le sud, ou s’unir pour marcher vers le nord.
Read more …
Dans cet article, je m’intéresse aux Gobirawa qui, à une époque, ont passé par l’Ayar1. Il serait vain de croire que cette communauté n’ait qu’une seule origine. Comme beaucoup de confédérations Berbère, Touareg ou même Hausa, les Gobirawa que l’on connaît aujourd’hui en tant que peuple du Hausa Bakwaï (les sept États Hausa légitimes), sont le résultat de migrations qui viennent des quatre points cardinaux et qui englobent aussi des autochtones. La diversité des traditions orales ou des écrits, des cousinages ou des us, ne reflètent en fait que les alliances qui se sont faites et défaites, de grès ou de forces, tout au long de leur histoire, par métissage ou assimilation successifs entre populations désireuses ou obligés de s’unir pour poursuivre leur histoire. Comprendre ces diversités n’est pas chose aisée.
Read more …
Cet article tente de comprendre les éléments que rapporte Ibn Battûta de son périple en Ighazer, afin de participer à la vision du cadre géographique et humain qu’apporte son récit à cette région, issu des traductions faites par Defrémery et Sanguinetti au milieu du XIXè et de celle de Joseph Cuoq à la fin du XXè siècle (Defrémery and Sanguinetti 1858; Cuoq 1975). Il est donc à l’évidence ethno-géo-centré sur la ville de Tacaddâ et sa région. Néanmoins pour comprendre ce cadre géographique, les sources écrites arabes médiévales apporteront un peu plus de consistance à ce récit. Ces sources sont essentiellement issues du « Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIè au XVIè siècle » de Joseph Cuoq.
Read more …
A partir du XVè siècle s’instaure un fort mouvement de lettrés et religieux venus de l’ouest, des Sanhadja de Walata, Tombouctou et Tademekka. Ce mouvement semble s’intensifier avec l’avènement de Sonni Ali Ber et l’empire Songhay à la fin de ce siècle. Ces personnages professent un islam plus rigoriste et puritain, dont Al Maghili en est un représentant qui passa par Takadda, devenue dès le XIVè siècle un important centre de diffusion spirituel. A la chute de Takadda, Anisaman va prendre le relais mais uniquement sur plan religieux, Agadez s’accaparant les pouvoirs politique et économique (Bernus et Cressier 1992), puis évinçant définitivement Anisaman au XVIIè siècle.
Read more …
Cet article s’intéresse au développement des débuts de l’islam en Aïr, qui s’étalent du VIIIᵉ siècle au XVIᵉ siècle. Chronologiquement, cette période s’insère d’abord dans ce que j’ai appelé le Domaine de Maranda, qui ne possède pas d’entité politique ou religieuse identifiée, mais fait davantage office de milieu culturel où la rencontre des populations se fait autour de Maranda, notamment lors du passage des caravanes commerciales. Ensuite, à partir du XIᵉ-XIIᵉ siècle, c’est le royaume de Tigidda qui est considéré comme le premier sultanat entre Ighazer et Aïr et qui sera confronté au sultanat d’Agadez, dont l’avènement sera effectif au tournant du XVIᵉ siècle. La fin de Tigidda marquera également la fin d’un islam élitiste, à la charnière des XVᵉ et XVIᵉ siècles et le cadre final de cet article.
Read more …
Pour la plupart des auteurs arabes médiévaux, les Masūfa ou Messufa, Imassufa, Inassufen, sont des Sanhadja, aux côtés des Gedāla et Lamtūna (Cuoq 1975). Ce sont des mulethemin, c’est à dire qu’ils portent le voile et habitent le désert. Toutes les tribus sanhadjiennes, Gueddala, Lemtuma, Messufa, Outzila, Targa, Zegaoua et Lemta, sont situées entre l’océan et Ghadamès (Baron de Slane 1982). Les Messufa peuvent être divisés en deux fractions, dont l'une, occidentale, a eu une part importante dans la fondation de l'Empire Almoravide, tandis que la fraction orientale est née sur le chemin des pèlerinages vers la Mecque et nous intéresse particulièrement ici, car elle est fondatrice de Takadda (Beltrami 1983).
Read more …